La question de l’interprétation dans l’Eglise ancienne.
 Sur ce point, saint Vincent était en plein accord avec la tradition établie. Comme l’avait magnifiquement dit saint Hilaire de Poitiers : « Les Ecritures ne sont pas le texte qui se lit, mais le sens qui se comprend [7] ». La question de la bonne exégèse restait un enjeu brûlant au Quatrième siècle, dans le débat de l’Eglise avec les ariens, tout comme elle l’avait déjà été au Second siècle, au cours de la lutte contre les gnostiques, les sabelliens et les montanistes. Tous les partis en présence avaient recours à l’Ecritures. Les hérétiques, comme les gnostiques et les manichéens, citaient volontiers des textes et passages scripturaires et ils invoquaient l’autorité de la Sainte Ecriture. En outre, l’exégèse était, à cette époque, la principale, sinon la seule, méthode de la théologie ; l’autorité de l’Ecriture régnait souverainement. Les orthodoxes se devaient donc de soulever la question cruciale de l’interprétation :
Sur ce point, saint Vincent était en plein accord avec la tradition établie. Comme l’avait magnifiquement dit saint Hilaire de Poitiers : « Les Ecritures ne sont pas le texte qui se lit, mais le sens qui se comprend [7] ». La question de la bonne exégèse restait un enjeu brûlant au Quatrième siècle, dans le débat de l’Eglise avec les ariens, tout comme elle l’avait déjà été au Second siècle, au cours de la lutte contre les gnostiques, les sabelliens et les montanistes. Tous les partis en présence avaient recours à l’Ecritures. Les hérétiques, comme les gnostiques et les manichéens, citaient volontiers des textes et passages scripturaires et ils invoquaient l’autorité de la Sainte Ecriture. En outre, l’exégèse était, à cette époque, la principale, sinon la seule, méthode de la théologie ; l’autorité de l’Ecriture régnait souverainement. Les orthodoxes se devaient donc de soulever la question cruciale de l’interprétation : Quel en était le principe de base ?
Il faut savoir qu’au Second siècle, le terme d’Ecritures se référait principalement à l’Ancien Testament et que, par ailleurs, l’autorité de ces Ecritures était violemment attaquée, et concrètement rejetée, par la doctrine de Marcion. L’unité de la Bible, voilà ce qu’il fallait défendre et démontrer. Quel était donc le principe et la garantie de la compréhension chrétienne et christologique de ce qu’on appelait la « Prophétie », autrement dit de l’Ancien Testament ? Tel est le contexte historique dans lequel, pour la première fois, on invoqua la Tradition.
On déclara que l’Ecriture appartenait à l’Eglise et que ce n’était qu’à l’intérieur de l’Eglise, dans la communauté de la foi droite, que l’Ecriture pouvait être adéquatement comprise et justement interprétée. Les hérétiques, c’est-à-dire ceux qui se trouvaient hors de l’Eglise n’avaient pas la clé du sens de l’Ecriture. Il ne suffisait pas de lire et de citer des paroles extraites de l’Ecriture, il fallait encore faire clairement connaître la vraie signification, le vrai propos de l’Ecriture prise dans son ensemble comme un tout indissociable. On devait en quelque sorte saisir d’avance le plan général de la révélation biblique, le grand dessein de la Providence rédemptrice de Dieu, ce qui n’était possible qu’aux yeux de la foi.
C’est la foi qui rendait capable de discerner le témoignage sur le Christ (Christuszeugniss) dans l’Ancien Testament. C’est la foi qui faisait connaître adéquatement l’unité des quatre Evangiles. Mais cette foi n’était pas la conviction arbitraire et subjective des individus, c’était la foi de l’Eglise, enracinée dans le message apostolique, dans le kérygme, qui lui conférait son authenticité. Ce qui manquait aux personnes extérieures à l’Eglise, c’était précisément ce message premier, fondamental et déterminant, vrai cœur de l’Evangile. Pour ces gens du dehors, l’Ecriture était lettre morte ; ou tout au plus un ensemble de textes et d’histoires sans lien entre eux, qu’ils s’efforçaient d’ordonner ou de ré-ordonner selon leurs propres schémas, tirés de sources étrangères. Ils avaient une autre foi. Tel est le principal argument utilisé par Tertullien dans son traité enflammé "Sur la Prescription des hérétiques".
Il ne voulait pas discuter sur les Ecritures avec les hérétiques : ils n’avaient pas le droit d’en faire usage, car les Ecritures ne leur appartenaient pas. Elles étaient le bien de l’Eglise. Tertullien insistait fortement sur la priorité donnée à la « règle de foi », regula fidei. Elle était la seule clef pour comprendre l’Ecriture. Et cette « règle » était apostolique, enracinée dans, et découlant de l’enseignement des Apôtres.
C.H. Turner a bien caractérisé le sens et les intentions de ce recours ou de cette référence à la « règle de foi » dans l’Eglise primitive. « Lorsque les chrétiens parlaient de la "règle de foi" en l’appelant "apostolique", ils ne voulaient pas dire que les Apôtres l’avaient découverte et formulée… Ce qu’ils entendaient par là, c’est que la profession de foi que chaque catéchumène récitait avant son baptême contenait en résumé la foi que les Apôtres avaient enseignée et confiée à leurs disciples pour l’enseigner à leur suite ». Cette confession était la même partout, bien qu’elle fût susceptible, dans son expression, de variations locales. Elle était toujours en étroite liaison avec la formule du baptême [8]. Hors de cette «règle», l’Ecriture ne pouvait être que mal interprétée. Ecriture et Tradition, pour Tertullien, étaient indissolublement imbriquées. « C’est à l’endroit où se révèlent la vraie doctrine et la vraie foi chrétienne, qu’on trouvera aussi vérité des Ecritures, des interprétations et de toutes les traditions des chrétiens » [9]. La Tradition de la foi apostolique constituait le guide indispensable à l’intelligence de l’Ecriture et l’ultime garantie de l’interprétation juste. L’Eglise, loin d’être une autorité extérieure, qui aurait eu à juger de l’Ecriture, était plutôt le dépositaire et le gardien de la Vérité Divine, contenue et conservée dans la Sainte Ecriture [10].
[7] Scripturae enim non in legendo sunt, sed in intelligendo, phrase tirée de l’Ad Constantium Aug., lib. II, cap. 9, ML X, 570 ; reprise par saint Jérôme, Dial. c. Lucifer., cap. 28, ML XXIII, 190-191.
[8] C.H. Turner, « Apostolic Succession », Essays on the Early History of the Church and the Ministry, edited by H.B. Swete, London 1918, p.101-102. Voir aussi Yves M.J. Congar, o.p., La Tradition et les traditions, II. Essai Théologique, Paris 1963, p. 21 sqq.
[9] Ubi enim apparuerit esse veritatem disciplinae et fidei christianae, illic erit veritas scipturarum et expositionum et omnium traditionum christianarum, texte cité, 19,3.
[10] Cf. E. Flesseman-van-Leer, Tradition and Scripture in the Early Church, Assen 1954, p.145-185 ; Damien van den Eynde, Les Normes de l’Enseignement chrétien dans la littérature patristique des trois premiers siècles, Gembloux-Paris 1933, p. 197-212 ; J.K. Stirniman, Die Praescriptio Tertullians im Lichte des römischen Rechts und der Theologie, Freiburg 1949 ; ainsi que l’instruction et les notes de R.F. Refoulé, o.p., dans l’édition «Sources Chrétiennes» du De praescriptione, tome 46 de cette collection, Paris 1957.

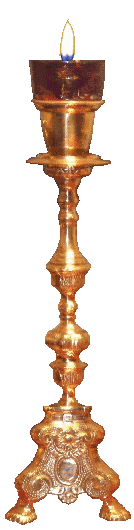



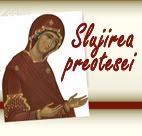













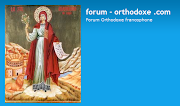










































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire